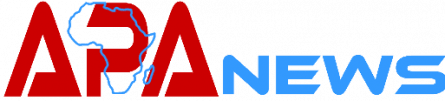La tension désormais apaisée autour de l’avenir de Macky Sall en tant que président du Sénégal au-delà de 2024, date à laquelle son pays se rendra aux urnes, a fasciné le reste du monde, et notamment l’Afrique de l’Ouest, compte tenu de ses relations turbulentes et parfois sanglantes avec des dirigeants politiques d’une époque révolue.
Des décennies plus tard, cette région aux cultures politiques jusqu’ici très diverses converge à nouveau vers le même point, où les dirigeants ont perdu le pouvoir et le lustre de dépasser leur date de péremption, comme le président Sall l’a découvert récemment, et comme son mentor devenu rival, Abdoulaye Wade, l’a réalisé plus d’une décennie auparavant avec sa tentative malavisée et par la suite malheureuse, de s’imposer au peuple sénégalais.
Contrairement à Wade, Sall n’a même pas été autorisé à aller aussi loin avec les citoyens sénégalais désenchantés qui ont clairement fait savoir qu’ils n’avaient aucun appétit pour un pouvoir auto-perpétué, si c’est ce que le langage codé derrière sa réticence « de sang-froid » indiquait.
Les manifestations de colère qui ont accompagné le suspense politique sur la candidature à un troisième mandat ou sur le respect de la constitution de son pays (dont les dispositions relatives à la limitation du nombre de mandats présidentiels ont été modifiées sous son mandat) ont braqué les projecteurs sur la région ouest-africaine dans son ensemble, sur la liste des transgresseurs politiques passés, présents et futurs qui cherchent à s’accrocher au pouvoir par tous les moyens nécessaires, tout simplement parce qu’ils ne seront jamais
rassasiés.
Pour mémoire, la majorité des pays d’Afrique de l’Ouest ont inscrit des limites de mandat dans leur constitution et leurs dirigeants sortants semblent les respecter à la lettre, à l’exception de la Guinée où l’ancien président Alpha Condé s’est brièvement succédé à lui-même après avoir « gagné » un troisième mandat, pour fournir involontairement une excuse aux militaires afin qu’ils s’emparent à nouveau du pouvoir et mettent fin à sa « folie anticonstitutionnelle » quelques mois plus tard.
L’autre pays est la Côte d’Ivoire, où le président Alassane Ouattara a fait un retour improbable après la mort de Amadou Gon Coulibaly, son Premier ministre et successeur désigné à l’approche de la onzième heure de l’élection de 2021, ce qui lui a valu la distinction douteuse d’un survivant politique à la manière d’un chat avec neuf vies.
Seuls les minuscules États du Togo et de la Gambie, dont les constitutions respectives ne limitent pas le nombre de mandats présidentiels, ainsi que le Burkina Faso, le Mali et la Guinée, dirigés par des juntes, échappent à cette tendance des deux mandats présidentiels, bien qu’ils aient à leur actif des contextes politiques différents.
Les exceptions de la région
Les pays de la région qui devraient montrer l’exemple, comme le Nigeria, le Ghana et le Sénégal, ont effectué de nombreuses transitions louables entre des dirigeants qui ont été battus ou dont le mandat a expiré et des successeurs qui sont forcés de reconnaître qu’ils se heurteraient à un obstacle coûteux s’ils essayaient de déjouer le « piège constitutionnel ».
L’ancien président Muhammadu Buhari salive désormais à l’idée d’une retraite paisible après avoir passé le relais à son successeur élu, Bola Ahmed Tinubu. Il s’agit du dernier cas en date d’une passation de pouvoir pacifique au Nigeria, où de telles transitions sans heurts ont eu lieu quatre fois sans faillir, depuis l’avènement des élections démocratiques en 1999.
Le retour du Ghana au pluralisme démocratique, qui remonte au début du siècle, a vu quatre transferts de pouvoir, de Jerry John Rawlings à John Kuffour, John Atta-Mills, John Dramani Mahama et Nana Akufo-Addo.
Le Cap-Vert, la Sierra Leone, le Liberia et le Niger en sont d’autres exemples bien connus: des présidents contraints par des dispositions constitutionnelles de se représenter ont présidé pacifiquement des élections et ont organisé des passations de pouvoir élaborées et gracieuses avec les futurs vainqueurs.
Le président sénégalais Sall a tenté de revenir en arrière, mais avec des conséquences désastreuses et peut-être involontaires, salissant l’image de son pays en tant que bastion chéri du constitutionnalisme démocratique comme aucun autre en Afrique de l’Ouest.
Les morts des manifestations et la destruction des infrastructures et des biens à Dakar et dans d’autres villes sénégalaises en ont fait une affaire très coûteuse.
Il s’agit là d’un autre exemple du pouvoir populaire en Afrique de l’Ouest qui a frappé au cœur même du patronage politique et qui a eu des conséquences dévastatrices pour les présidents rigides et leurs tactiques musclées de trafic d’influence et de contrôle.
Cela aurait tiré la sonnette d’alarme dans les capitales tranquilles de l’Afrique de l’Ouest, où les dirigeants aux ambitions bien arrêtées devraient peut-être réfléchir longuement et sérieusement aux péchés et aux folies qui consistent à prolonger leur séjour et à plonger leurs pays dans des crises évitables, comme celles dont le monde a été témoin en Côte d’Ivoire sous Laurent Gbagbo, dans une Algérie dirigée par feu Abdelaziz Bouteflika et au Soudan par Omar al-Bashir.
D’autres exemples plus sanglants sont Mouammar Kadhafi en Libye et Samuel Doe au Liberia, chassés du pouvoir par des rébellions armées lorsque tous les moyens démocratiques pour un transfert pacifique du pouvoir ont échoué.
Pas de retour à l’âge de pierre politique en Afrique de l’Ouest
L’Afrique de l’Ouest a parcouru un long chemin depuis l’époque où ses anciens dirigeants, à l’exception de quelques-uns, s’accrochaient au pouvoir avec aplomb, sachant qu’aucune disposition constitutionnelle ne leur interdisait de s’auto-perpétuer.
Ce n’était pas l’époque des institutions démocratiques fortes ou des sociétés civiles véhémentes, qui mettaient les dirigeants au pied du mur ou les talonnaient pour une transgression politique ou une autre.
C’était l’époque où des chefs suprêmes comme Félix Houphouët-Boigny de Côte d’Ivoire se comportaient comme des êtres suprêmes dont les caprices suffisaient à diriger un pays et sa population soumise.
Ils étaient les lois de leurs pays sous une forme humaine et pouvaient reprendre le célèbre « l’Etat c’est moi » de Napoléon Bonaparte dans une diatribe décontractée, sans s’attendre à des conséquences sociopolitiques qui pourraient les voir chassés du pouvoir par des révoltes populaires, telles que celle contre Blaise Compaoré au Burkina Faso en 2014.
En l’absence d’institutions fortes, feu Boigny et ses semblables en Afrique de l’Ouest et au-delà étaient si puissants qu’ils soumettaient tout et tout le monde à leurs caprices personnels, à leur influence et à leur contrôle.
Ils pouvaient ainsi changer le cours de l’histoire de leur pays par la seule force de leurs caprices et de leurs lubies, même si les conséquences impliquaient d’interdire ou de liquider physiquement les opposants, réels ou supposés, de s’éterniser au pouvoir et de jouir des avantages qui en découlent.
C’est également le cas dans d’autres régions d’Afrique où le pouvoir est la finalité ultime et la touche magique de Midas qui garantit tout ce que la vie a à offrir à ceux qui occupent des postes haut placés, en particulier les présidents.
Il ne fait aucun doute que l’Afrique est toujours gouvernée par des hommes forts – Teodoro Obiang Nguema Mbasogo de Guinée équatoriale, Paul Biya du Cameroun et Yoweri Museveni de l’Ouganda sont des exemples évidents de dirigeants qui sont là depuis la nuit des temps.
Toutefois, l’évolution constante des dirigeants politiques africains peut garantir que cette norme appartient à un passé révolu et ne peut plus avoir cours lorsque le pouvoir populaire renverse la fortune des dirigeants du jour au lendemain et les rend spectateurs impuissants pendant que l’histoire se déroule sans eux.
AS/fss/ac/APA